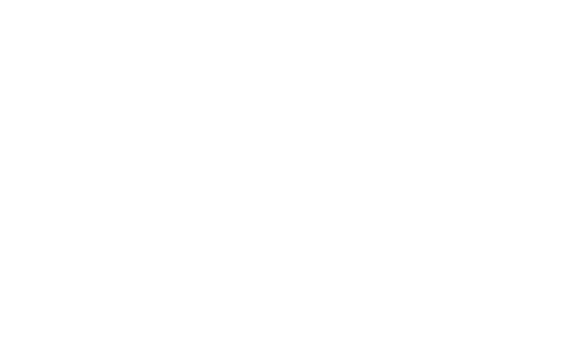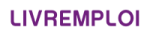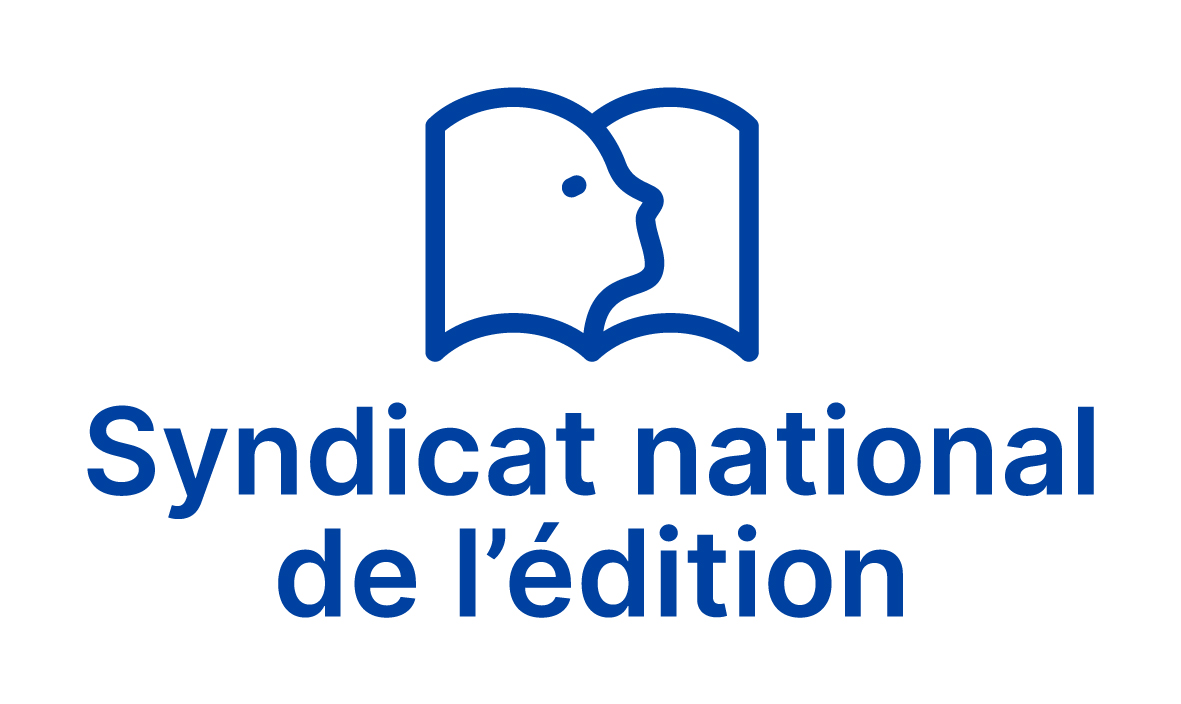- Actualité
Rémunération en droit d’auteur sur la vente de livres d’occasion : le Conseil d’État se prononce

Article paru dans Dalloz Actualité le 25 septembre 2025
Le 17 juin 2025, le Conseil d’État a rendu son avis relatif à la rémunération en droit d’auteur sur la vente de livres d’occasion1. La demande d’avis du gouvernement était formulée ainsi : « l’institution d’un principe de rémunération sur les livres d’occasion au bénéfice des auteurs […] serait-elle contraire au droit de l’Union européenne, notamment la directive 2001/29/CE, ou à une règle ou un principe de valeur constitutionnelle ? »
CE, avis, 17 juin 2025, n° 409596
Le projet d’une rémunération sur la vente de livres d’occasion est porté par le Syndicat national de l’édition (SNE)2. Le SNE s’est emparé de la question en raison de l’explosion, ces dernières années, du marché de l’occasion, ce qui est principalement dû à la montée en puissance des plateformes numériques sur ce terrain, qu’elles se positionnent comme vendeurs ou comme intermédiaires. Ce fait est aujourd’hui documenté3, le marché de seconde main n’est plus à proprement parler un marché de l’occasion dès lors qu’en quelques clics depuis un ordinateur ou un smartphone, il est possible de trouver un titre, de l’acheter pour quelques euros et de se le faire livrer, quand, dans le monde analogique, l’achat d’occasion relève d’une rencontre fortuite. Le marché de l’occasion s’est accru en volume, il se substitue à des achats qui, auparavant, auraient été réalisés sur le marché primaire et il vient ainsi concurrencer directement ce premier marché, constituant un fort manque à gagner pour les auteurs et éditeurs qui, à l’heure actuelle, ne perçoivent aucune rémunération sur ce marché. Par ailleurs, le phénomène de l’occasion nuit à la perception d’un prix unique du livre puisqu’il n’est pas rare de trouver, quelques jours (heures !) après la sortie d’un nouveau titre, des exemplaires d’occasion pour un prix inférieur au prix éditeur. Pour l’ensemble de ces raisons, le Conseil permanent des écrivains4 est également favorable au projet5 qui prévoit un partage à parts égales entre les auteurs et les éditeurs du fruit de la rémunération sur les ventes d’occasion.
Le sujet est donc débattu dans les sphères de l’édition et au sein du ministère de la Culture depuis quelques mois. Il a trouvé un écho favorable au plus haut niveau politique puisque le président de la République s’est exprimé en faveur du projet, à deux reprises6. Nous avons été personnellement sollicitée par le SNE pour rendre une étude juridique académique sur la question et c’est ce qui a forgé notre conviction que le projet d’une rémunération en droit d’auteur sur la vente de livres d’occasion est solide. Nous proposons ici notre analyse de l’avis du Conseil d’État pour poursuivre le débat dans la sphère juridique.
Avec cet avis, le projet entre dans une phase juridique plus concrète mais il reste à savoir s’il lui reste encore un avenir, au regard de l’avis partiellement négatif rendu. L’enjeu principal est de déterminer si la règle d’épuisement du droit de distribution est compatible ou non avec la rémunération des auteurs et éditeurs lors des ventes d’occasion des supports papier de l’œuvre. La question de la compatibilité avec le droit constitutionnel a également pu être soulevée.
Saisi de ces questions par le gouvernement, le Conseil d’État formule l’avis que la rémunération sur la vente d’occasion n’est pas contraire au droit constitutionnel mais, qu’en revanche, elle soulève des questions relatives à la compatibilité avec le droit européen, qui comprend la question de l’épuisement mais également la question des règles applicables aux plateformes.
L’analyse de la constitutionnalité du projet
La question de la constitutionnalité soulève principalement deux problèmes : d’une part, la compatibilité avec le droit de propriété et la liberté contractuelle du vendeur ; d’autre part, la question de l’égalité devant la loi.
D’une part, le droit à rémunération en cause soulève un problème de compatibilité avec la liberté contractuelle – la vente d’occasion est un contrat dont la mise en œuvre serait soumise au droit à rémunération sur la revente d’occasion – et le droit de propriété du revendeur – c’est sur le fondement de son droit de propriété que le revendeur prend la décision de revendre son exemplaire. Or, le Conseil d’État considère que « ni le droit de propriété de l’acquéreur d’un livre d’occasion, ni la liberté contractuelle protégées par la Constitution, non plus qu’aucun autre principe ou aucune autre règle de nature constitutionnelle ne fait obstacle à la perception d’un nouveau droit d’exploitation d’une œuvre littéraire, à l’occasion des reventes successives des livres imprimés ». Pour parvenir à cette conclusion, le Conseil d’État considère d’abord que l’atteinte au droit de propriété corporelle est justifiée car elle s’explique par le renforcement des droits de propriété intellectuelle des titulaires de droits d’auteur qui relèvent du droit de propriété protégé aux articles 2 et 17 de la Déclaration de 17897. En outre, la perception d’une rémunération lors d’une revente d’occasion concourt à « la promotion de la création artistique et à la sauvegarde de la propriété intellectuelle, reconnue comme objectif de valeur constitutionnelle »8.
Le Conseil d’État considère ensuite que l’atteinte n’est pas disproportionnée eu égard à l’objectif poursuivi, tant que les modalités de mise en œuvre du droit à rémunération ne privent pas les revendeurs de la perception du prix de revente. Ce point ne fait pas difficulté dès lors que, dans le projet envisagé, le droit à rémunération serait calculé comme un pourcentage (modeste) du prix de revente. Le Conseil d’État considère ainsi que le projet est compatible avec le droit constitutionnel9.
D’autre part, la question de la compatibilité avec le principe d’égalité devant la loi est soulevée. Le Conseil d’État considère que le projet n’y porte pas atteinte dès lors que le système « s’appliquerait indifféremment du mode de commercialisation, physique ou en ligne, de livres d’occasion ». À l’inverse, donc, un droit à rémunération qui ne s’appliquerait qu’aux ventes en ligne pourrait être contraire au principe d’égalité devant la loi. En revanche, le Conseil d’État précise qu’il est envisageable de différencier le traitement des différents opérateurs suivant leurs catégories économiques – on imagine, au regard d’un volume de chiffres d’affaires ? en raison du but purement lucratif ou non poursuivi par l’opérateur ? – tant que « les différences de situation objectives en lien avec les buts poursuivis » le justifieraient. Ici, le Conseil d’État, sans entrer dans les détails, semble donc souscrire aux modalités du projet et notamment à l’idée d’exempter les acteurs relevant de l’économie sociale et solidaire pour lesquels le commerce de livres d’occasion ne représente qu’une part minoritaire de l’activité, comme les opérateurs économiques ne dépassant par un volume de chiffre d’affaires annuel10.
Dans son analyse de l’articulation avec le droit constitutionnel, le Conseil d’État inscrit donc le droit à rémunération lors de la vente d’occasion d’un livre papier dans le cadre d’un objectif à valeur constitutionnelle et valide un certain nombre des modalités de mise en œuvre envisagées, notamment la différenciation entre les acteurs concernés en fonction de critères objectifs. Pour autant, la compatibilité avec le droit européen fait, selon lui, difficulté.
L’analyse de la compatibilité du projet avec le droit européen
Le cœur de l’analyse réside dans la compatibilité d’un système de rémunération lors de la revente d’un livre papier avec la règle d’épuisement du droit de de distribution. La réponse est loin d’être évidente et on pourrait même penser, spontanément, qu’elle n’a pas à se poser, puisque l’épuisement du droit de distribution est souvent présenté – trop rapidement selon nous – comme une règle selon laquelle l’auteur ne peut exercer et percevoir de rémunération que lors de la première vente du support, avec son accord. Il n’en reste pas moins que les arguments du Conseil d’État pour parvenir à la conclusion de l’incompatibilité avec le droit européen nous semblent fragiles.
Pour commencer, le Conseil d’État reconnaît que « prise à la lettre », la directive 2001/29/CE, qui définit en son article 4 le droit de distribution et son épuisement, pourrait autoriser une rémunération au bénéfice de l’auteur lors des reventes successives. En effet, l’article 4 de la directive définit la distribution comme étant « le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute forme de distribution au public ». En outre, le considérant 28 – non visé expressément par le Conseil d’État – qui éclaire la notion d’épuisement précise que « la protection du droit d’auteur en application de la présente directive inclut le droit exclusif de contrôler la distribution d’une œuvre incorporée à un bien matériel. La première vente dans la Communauté de l’original d’une œuvre ou des copies de celle-ci par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de contrôler la revente de cet objet dans la Communauté » (nous soulignons). Les termes employés visent donc uniquement la question du choix de revendre ou non, choix qui n’appartient plus à l’auteur passé le premier transfert de propriété. C’est, selon nous, un argument fort qui permettrait de reconnaître la possibilité, au bénéfice des titulaires de droits, de percevoir une rémunération lors des reventes successives11. Le Conseil d’État ne se contente toutefois pas de cette analyse et poursuit son analyse en deux temps : d’une part, il cherche à déterminer la portée de l’épuisement pour, d’autre part, établir si les États membres bénéficient d’une certaine marge de manœuvre à cet égard.
La portée de l’épuisement selon le Conseil d’État
D’abord, le Conseil d’État articule son raisonnement autour de la notion « d’exploitation commerciale du droit d’auteur »12. Selon l’avis, la notion d’exploitation commerciale du droit d’auteur « constitue à la fois une source de rémunération pour son titulaire et une forme de contrôle de la commercialisation par ce dernier », ce qui se déduirait d’une décision de la Cour de justice de 1981, l’arrêt Musik Vertrieb13. Dès lors, le Conseil en déduit que l’épuisement du droit de distribution comprend non seulement l’épuisement du « droit de contrôle sur la commercialisation » mais également l’épuisement « du droit de percevoir une rémunération sur les cessions ultérieures » du support de l’œuvre. L’analyse est assez lapidaire et ne convainc pas, pour une série de raisons.
Pour commencer, le fait même d’articuler toute l’analyse autour de la « notion d’exploitation commerciale du droit d’auteur »14 est problématique. En effet, ce qui s’épuise en droit d’auteur, c’est uniquement le droit de distribution, soit la vente d’un support matériel de l’œuvre ou tout autre transfert de propriété sans vente. En analysant la notion d’exploitation commerciale du droit d’auteur, le Conseil d’État déplace la question du champ de l’épuisement et semble assimiler distribution et exploitation commerciale, en faire des termes équivalents. Or la notion « d’exploitation commerciale » n’apparaît à aucun endroit dans la directive 2001/29/CE, pas plus qu’elle n’apparaît dans le code de la propriété intellectuelle. La directive vise la notion de distribution de l’œuvre au public ou encore la notion de « première vente » ou de « premier autre transfert de propriété » qui vient déclencher l’épuisement du droit de distribution15 ou, plus généralement, « l’exploitation des œuvres », ce qui ne relève pas nécessairement de la sphère de la commercialité16. Le code de la propriété intellectuelle vise, lui, la « vente d’un ou des exemplaires matériels d’une œuvre » au sujet de l’épuisement et, plus généralement, l’exploitation des œuvres, qui se décline schématiquement en deux catégories, la reproduction et la représentation des œuvres. En outre, à supposer que la notion d’exploitation commerciale du droit d’auteur soit une notion consistante du droit d’auteur, celle-ci dépasse largement la question de la distribution de l’œuvre : l’exploitation commerciale renvoie à toute utilisation d’une œuvre soumise au droit d’auteur qui, en outre, génère une rémunération. Aussi, toute exploitation de l’œuvre n’est pas sujette à épuisement. On peut donc souscrire à l’idée que l’exploitation commerciale d’une œuvre suppose un contrôle par l’auteur de cette commercialisation et une rémunération de celui-ci. Mais en quoi cela implique-t-il que l’épuisement du droit de distribution exclut toute rémunération ? D’ailleurs, la directive prévoit que le droit de distribution s’épuise, quand bien même le support de l’œuvre n’aurait pas été vendu : il suffit qu’il y ait un transfert de propriété, ce qui peut être gratuit et donc en dehors de toute exploitation commerciale17. Autrement dit, si l’exploitation commerciale suppose un contrôle et une rémunération, pourquoi en déduire que l’épuisement du droit de distribution – qui est une forme parmi d’autres d’exploitation de l’œuvre – exclut toute rémunération, la distribution n’étant, par ailleurs elle-même pas toujours une forme d’exploitation commerciale.
Par ailleurs, les enseignements tirés de l’arrêt Musik Vertrieb se discutent aussi. Il semble que le Conseil d’État renvoie en particulier au § 13 de cette décision, ainsi libellé : « si l’exploitation commerciale du droit d’auteur constitue une source de rémunération pour son titulaire, elle constitue également une forme de contrôle de la commercialisation par le titulaire […] ». Mais là aussi, en quoi cette décision implique-t-elle que l’épuisement s’étende à la perception d’une rémunération ? Dans l’arrêt, il s’agissait pour la Cour de justice de considérer que le droit d’auteur était assujetti à l’épuisement comme tout « autre droit de propriété industrielle ou commerciale »18.
La décision ne règle pas, selon nous, la question de la portée de l’épuisement mais uniquement celle de l’applicabilité au droit d’auteur de la théorie de l’épuisement, avant sa consécration textuelle vingt ans plus tard19. On pourrait d’ailleurs souligner le fait que la Cour elle-même distingue bien le contrôle de la commercialisation par l’auteur de la rémunération de l’auteur, ce qui va dans le sens d’une nuance de la portée de l’épuisement – l’épuisement du contrôle n’emportant pas nécessairement épuisement de la rémunération.
En toute hypothèse, il ne nous semble pas possible de déduire, comme le fait le Conseil d’État, sur le fondement des arguments convoqués, que « la règle de l’épuisement du droit de distribution à première cession emporte donc à la fois épuisement du droit de contrôle sur la commercialisation et du droit de percevoir une rémunération sur les cessions ultérieures du support sur lequel l’œuvre est matérialisée ». Pour nous la question reste entière et, rien, ni dans les textes européens, ni dans la jurisprudence de la Cour – à qui on n’a jamais posé directement la question – ne permet de dire que l’épuisement du droit de distribution exclut toute forme de rémunération pour les reventes successives.
D’ailleurs, il existe en droit d’auteur européen un mécanisme qui va dans le sens de notre analyse – et qui sert d’ailleurs de modèle au projet : le droit de suite pour les œuvres d’art. Ce droit, consacré par la directive 2001/84/CE du 27 septembre 2001, permet à l’auteur d’une œuvre d’art qui a déjà procédé à une première vente, de percevoir un pourcentage du prix de vente lors des reventes successives. L’auteur ne peut contrôler le principe de la vente ; il se contente d’un droit à rémunération. Or, jamais le droit de suite n’a été envisagé comme contraire à l’épuisement du droit de distribution20.
La marge de manœuvre des États membres
Pour compléter son analyse, le Conseil d’État étudie, d’autre part, la question de savoir s’il serait possible qu’un États membre adopte une vision différente de l’épuisement, qui n’exclurait pas la perception d’une rémunération. Il s’agit de déterminer l’impérativité de la notion d’épuisement. Là aussi notre analyse diverge de celle du Conseil d’État. Ce dernier se fonde sur deux arrêts de la Cour de justice, rendus en 2006 et 201521. Le Conseil extrait de ces décisions la phrase suivante : l’article 4.2 de la directive « ne laisse pas aux États membres la faculté de prévoir une règle d’épuisement autre que celle prévue par cette disposition » et se fonde également sur le considérant 31 de la directive suivant lequel « la divergence des législations nationales en matière d’épuisement du droit de distribution est susceptible d’affecter directement le bon fonctionnement du marché intérieur ». Autrement dit, la règle de l’épuisement fait l’objet d’une harmonisation maximale qui ne laisse aucune marge de manœuvre aux États. Nous en doutons.
D’abord, lorsque la Cour précise qu’il n’est pas possible aux États membres de prévoir « une règle d’épuisement autre que celle prévue » par la directive, elle le fait pour restreindre la portée de l’épuisement européen. En l’occurrence, dans l’arrêt de 2006, Laserdisken, l’une des parties au contentieux cherchait à faire dire à la Cour que la directive 2001/29/CE, en prévoyant un épuisement européen, ne s’opposait pas au maintien d’une règle nationale permettant l’épuisement international22. Or, la Cour refuse, considérant que permettre un épuisement international dans certaines législations de l’Union européenne et pas dans d’autres constituerait une entrave au bon fonctionnement du marché intérieur. Autrement dit, l’argument, dans l’arrêt de la Cour, sert à limiter l’épuisement et à permettre un retour au droit exclusif pour la distribution internationale d’exemplaires d’œuvres alors que le Conseil d’État l’utilise pour étendre la portée de l’épuisement européen. On ajoutera que l’argument est relatif au marché intérieur alors que le projet de rémunération sur les reventes successives n’intéresse que le marché français.
Par ailleurs toute la question réside précisément dans le fait de savoir ce qu’est « la règle prévue » par l’article 4.2 de la directive, si elle comprend, ou non, le droit de percevoir une rémunération.
Quoi qu’il en soit, alors même qu’il affirme que la lettre de la directive ne s’oppose pas au droit à rémunération, le Conseil d’État ne peut pas prendre appui sur une règle d’harmonisation maximale pour affirmer que le droit à rémunération serait contraire à cette harmonisation.
La contrainte des plateformes
L’argument relatif aux obligations que l’on peut imposer aux plateformes est également discutable. D’abord, le Conseil d’État réfute que l’on puisse porter atteinte à la libre circulation des services de la société de l’information. Or, le projet de rémunération sur le marché de l’occasion ne porte pas atteinte à la libre circulation puisqu’il ne restreint pas la circulation des supports d’œuvres littéraires mais suppose la perception d’un pourcentage sur le prix de vente23.
Ensuite, le Conseil d’État considère que le projet, en imposant aux plateformes des obligations nouvelles (déclaration, collecte, reversement des rémunérations), porterait atteinte au principe de « responsabilité atténuée des hébergeurs ». Mais l’argument ne peut en soi invalider le projet, ne serait-ce parce que d’autres acteurs que des plateformes sont concernés – les revendeurs physiques – et, qu’en outre, toutes les plateformes numériques du marché de l’occasion ne peuvent pas être qualifiées d’hébergeurs. Certaines interviennent comme vendeurs, ce qui exclut la qualification d’hébergeurs. Les autres, intermédiaires lors de la vente, ne sont pas pour autant systématiquement qualifiables d’hébergeurs au regard de la jurisprudence24. Enfin, le principe de responsabilité atténuée des hébergeurs a-t-il vraiment un rapport avec la volonté d’imposer le respect d’un nouveau droit à rémunération ? Le règlement sur les services numériques est visé par le Conseil d’État25. Rappelons qu’il précise, en son considérant 11, que le texte est « sans préjudice du droit de l’Union sur le droit d’auteur et les droits voisins, y compris les directives 2001/29/CE, 2004/48/CE et (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil, qui établissent des règles et des procédures spécifiques qui ne devraient pas être affectées ». Autrement dit, si l’on admet que la directive 2001/29/CE n’exclut pas que l’épuisement du droit de distribution permette la perception d’une rémunération, le règlement préserve la mise en œuvre de cette règle. Toute la question étant donc, de déterminer si c’est bien le cas.
On le voit : la question de la portée de l’épuisement du droit de distribution est absolument centrale car, de cette analyse, découle toute la validité du système tel que pensé. Or, à la question de savoir si l’épuisement du droit de distribution comprend la perte du droit d’autoriser ou interdire la vente – ce qui est certain – mais également la possibilité de percevoir une rémunération – ce qui fait débat – le Conseil d’État répond par une approche maximaliste qui empêche toute possibilité de rémunération une fois la première vente de l’exemplaire de l’œuvre réalisée. Pour autant, les arguments avancés nous semblent fragiles et les jurisprudences qui servent de fondements au raisonnement ne disent pas du tout clairement que cette interprétation est la seule possible. Dans un contexte où la conformité du projet au droit constitutionnel est confirmée par le Conseil d’État lui-même, on ne peut que regretter cette orientation. Reste, qu’en creux, l’avis confirme que, décidément, des failles existent dans le raisonnement consistant à opposer épuisement des droits et rémunération en droit d’auteur.
- CE, avis, 17 juin 2025, n°409596
- Très schématiquement, il s’agit, de reconnaître un droit à rémunération aux auteurs et éditeurs d’un livre papier lors des reventes successives (pourcentage du prix de vente).
- v.Ministère de la Culture et SOFIA, B. Legendre [dir.], Le livre d’occasion 2023, l’étude établit, entre autres, à près de 20 % le volume de livres achetés d’occasion en 2022 et établit que le nombre d’acheteurs d’occasion a augmenté depuis 10 ans, à l’inverse des acquéreurs de livres neufs.
- Le Conseil permanent des écrivains, actuellement présidé par S. Weiss, regroupe une quinzaine d’organisations d’auteurs parmi lesquels la Société des gens de lettres (SGDL), le Syndicat national des auteurs compositeurs (SNAC), le Syndicat des écrivains de langue française (SELF), la Société civile des auteurs multimédia (SCAM), l’Association des traducteurs littéraires de France, etc.
- D’autres organisations sont plus réservées, à l’instar, semblerait-il, de la Ligue des auteurs professionnels ; le commentaire de l’avis du Conseil d’État, par S. Le Cam, Maître de conférences et également Directrice générale de la Ligue des auteurs professionnels, Avis du Conseil d’État : l’épuisement du droit de distribution s’oppose à une rémunération sur le livre d’occasion, Dalloz actualité, 11 sept. 2025.
- E.Macron s’est exprimé en avril 2024 et en avril 2025, à l’occasion du Festival du Livre, à Paris, en faveur d’une rémunération des auteurs lors de la vente de livres d’occasion.
- Depuis la décision du Conseil constitutionnel dite « DADVSI », Cons. const. 27 juill. 2006, C Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, n° 2006-540 DC, D.2006. 2157, chron. C. Castets-Renard ; ibid. 2878, chron. X. Magnon ; ibid. 2007. 1166, obs. V. Bernaud, L. Gay et C. Severino ; RTD civ. 2006. 791, obs. T. Revet ; ibid. 2007. 80, obs. R. Encinas de Munagorri .
- Le Conseil d’État renvoie à la décision Cons const. 20 mai 2020, n° 2020-841 QPC, qui ne vise d’ailleurs pas explicitement « la promotion de la création artistique » mais uniquement « l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la propriété intellectuelle » (§ 6). On ajoutera que la dimension d’intérêt général est ici renforcée par le fait qu’une partie de la rémunération perçue serait affectée à des actions d’intérêt général bénéficiant au secteur du livre, AJDA 1091 ; D. 2020. 1104, et les obs. ; ibid. 2262, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; Légipresse 2020. 341 et les obs. ; ibid. 443, étude V. Varet ; ibid. 240, égude N. Mallet-Poujol ; RTD com. 2020. 632, obs. F. Pollaud-Dulian .
- L’avis ne précise pas particulièrement la compatibilité avec la liberté contractuelle ; on suppose que la question ne se pose pas à l’égard du principe de revendre puisque le projet laisse l’acquéreur du support libre à cet égard. Sur les modalités de la revente (perception d’un pourcentage du prix de vente), ce qui est dit au sujet du droit de propriété quant à la justification de l’atteinte et l’absence de disproportion est transposable.
- Le seuil ayant vocation à être fixé par décret.
- Reventes dont le principe n’a pas été décidé par l’auteur.
- 6 de l’avis du CE.
- CJCE 20 1981, Musik-Vertrieb et al. c/ GEMA, aff. jtes nos 55/80 et 57/80.
- Ne faudrait-il pas plutôt viser la notion « d’exploitation commerciale de l’œuvre » ?
- CPI, art. L. 122-3-1.
- L’exploitation d’une œuvre peut être gratuite et pour autant relever du droit d’auteur.
- C’est le cas lorsque le transfert de propriété est opéré par la succession, par.
- C’est la suite de la décision Musik Vertrieb, 13.
- Le fondement d’une décision vieille de 40 ans interroge également, l’épuisement est une notion mouvante ; à ce sujet, M. Vivant, Propriété intellectuelle et libre circulation : à propos de l’épuisement du droit, in GAPI, 3e éd., Dalloz, 2020, nos 24-26, p. 134 s.
- V.très récemment, le rapport de la commission sur le droit d’auteur et la transition écologique (co-présid. : V.-L. Benabou et E. Gabla ; rapp. : A. Denieul) publié le 26 juin 2025 par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, spéc. p. 40, le droit de suite « qui se greffe sur les reventes successives d’un exemplaire physique d’une œuvre ne constitue pas une dérogation au principe de l’épuisement des droits, le titulaire n’ayant pas le droit d’autoriser ou d’interdire ces opérations, mais une simple modalité d’intéressement des titulaires lorsque ces ventes font l’objet d’une intermédiation par un professionnel ».
- CJCE, ch., 12 sept. 2006, Laserdisken ApS, aff. C-479/04 (ci-après « Laserdisken »), D. 2006. 2398, obs. J. Daleau ; RTD com. 2007. 80, obs. F. Pollaud-Dulian ; 22 janv. 2015, Art & Allposters International BV, aff. C-419/13 (ci-après « Allposters »), D. 2015. 776 , note C. Maréchal ; Légipresse 2015. 76 et les obs. ; RTD com. 2015. 283, obs. F. Pollaud-Dulian .
- Épuisement international qui, en l’occurrence aurait permis à un ressortissant d’un État membre d’importer librement des supports d’œuvres sur le territoire de l’UE car ils ont déjà été distribués en dehors du territoire de l’UE.
- La question de l’atteinte à la libre circulation avait pu être soulevée au moment de la législation sur le prix unique du livre. La CJUE avait jugé que la législation française ne portait pas atteinte au principe de libre circulation et ne relevait que d’une modalité de la vente, v. CJCE 10 janv. 1985, Leclerc c/ Au blé vert, aff. C-229/83.
- V. not., l’arrêt E-bay, Com. 3 mai 2012, n° 11-10.507, dans lequel la Cour de cassation approuve les juges du fond de ne pas avoir retenu la qualité d’hébergeur de la plateforme malgré son statut d’intermédiaire en raison de son « rôle actif » (rôle de la plateforme dans l’optimisation des ventes, dans la rédaction de l’annonce, dans l’orientation des acquéreurs vers des objets similaires, etc.), D. 2012. 2331, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 2343, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; ibid. 2836, obs. P. Sirinelli ; ibid. 2013. 732, obs. D. Ferrier ; ibid. 1503, obs. F. Jault-Seseke ; Légipresse 2012. 343 et les obs. ; ibid. 349 et les obs. ; ibid. 438, comm. M. Berguig .
- Règl. (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 oct. 2022 sur les services numériques.
par Sarah Dormont, Maître de conférences de droit privé – Vice-doyenne en charge de l’égalité des changes – Université Paris Est-Créteil (UPEC)