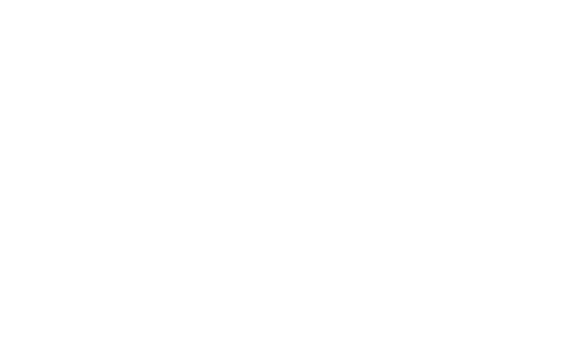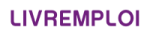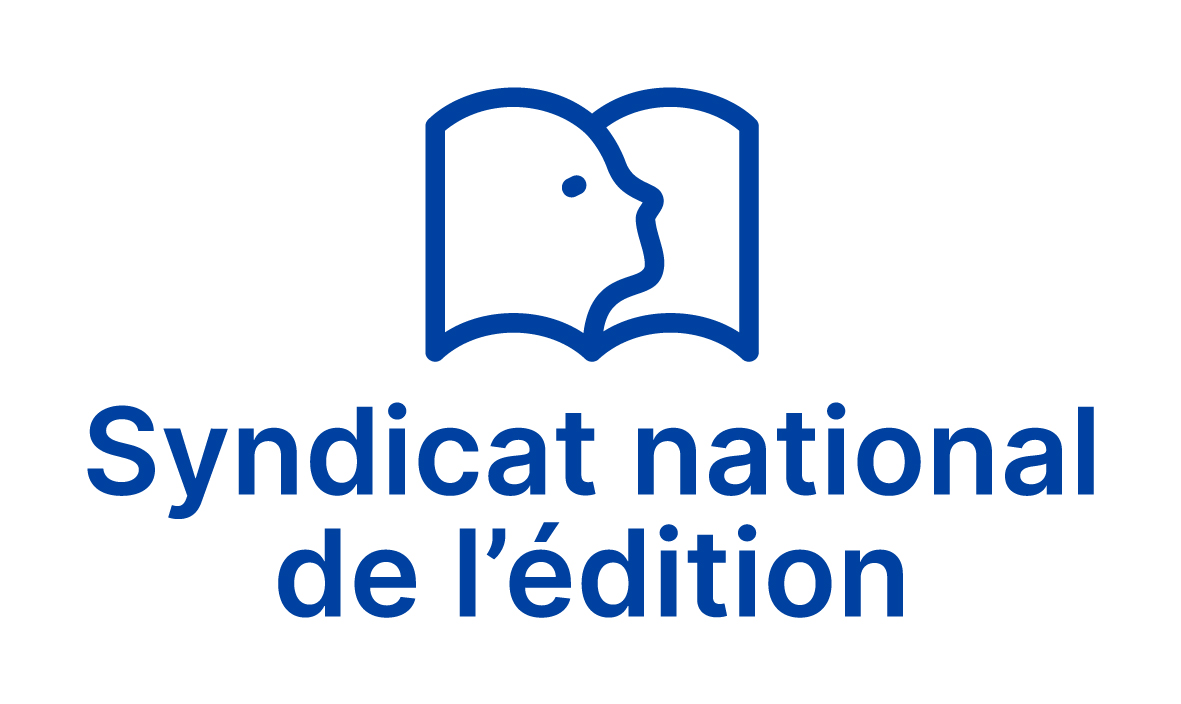Le mouvement Open Access
Ces dernières années, les éditeurs scientifiques ont cherché à répondre aux besoins des chercheurs en proposant de nouveaux services d’accès aux articles scientifiques : soit l’ouverture des archives après un délai d’embargo raisonnable, soit sous forme d’accès immédiat aux articles récents en contrepartie d’un paiement par l’institution d’appartenance de l’auteur.
Il s’agit d’expérimentations dont les effets sur les modèles économiques des revues et publications scientifiques doivent encore faire l’objet de tests, d’un examen sérieux des risques encourus pour la pérennité des revues et d’une concertation avec les organismes de recherche.
SOMMAIRE
La loi Lemaire
L’article 30 de la loi Lemaire a ouvert aux chercheurs français la possibilité de mettre en accès gratuit (open access) leurs publications scientifiques dans des délais très courts (six mois en sciences, techniques et médecine et douze mois en sciences humaines et sociales). Le SNE et la FNPS avaient alors pointé le risque de mettre en péril l’économie des éditeurs scientifiques et des plateformes qui diffusent ces publications. Par leur travail de sélection des articles, de mise en forme, de validation et de promotion de la connaissance, mais aussi en élaborant des moyens de conservation pérenne ou encore des outils performants de recherche à travers les bases de données, ils jouent un rôle essentiel en faveur de la recherche scientifique et du rayonnement international de la pensée, notamment française. Ce travail, ces innovations ont un coût. L’accès gratuit peut avoir des conséquences décisives sur la viabilité des revues d’édition scientifique.
Aujourd’hui, l’esprit de la loi « Pour une République numérique » pourrait être dévoyé, certains acteurs affichant désormais leur souhait de voir imposé un dépôt obligatoire ou quasi-obligatoire en accès gratuit des publications de recherche, sans tenir compte des spécificités des secteurs de publication et encore moins du modèle économique de chaque revue.
Dernières avancées dans le débat
Les politiques en faveur de l’open access tendent de plus en plus vers un affaiblissement du droit d’auteur : réflexions sur l’adaptation du droit d’auteur à la recherche, encouragement des chercheurs à ne plus céder leurs droits d’auteur, stratégies visant à se passer des éditeurs scientifiques privés. Cependant, ont été publiés trois rapports pertinents sur la « science ouverte » qui vont dans le même sens : plus d’interministérialité, et plus de prise en compte du travail des éditeurs.
Au niveau français
Ce mouvement se traduit par des contraintes croissantes à l’égard des chercheurs. Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) a de son côté annoncé son plan pour la science ouverte le 6 juillet 2021, invitant les chercheurs à ne pas céder leurs droits aux éditeurs. Parallèlement, un Observatoire de l’édition scientifique a été mis en place en décembre 2021, répondant à une attente de longue date des éditeurs scientifiques.
En mars 2022 a été publié le rapport sur la science ouverte de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) ainsi que l’avis du Médiateur du livre sur l’édition scientifique en avril 2023. Les éditeurs scientifiques du SNE et la Fédération Nationale de la Presse Spécialisée (FNPS) s’en sont félicités.
Ces rapports reconnaissent le rôle fondamental des éditeurs scientifiques privés et publics pour la diffusion des résultats de recherche. Ils demandent une approche équilibrée de la politique française de science ouverte garantissant le pluralisme, la diversité, respectant les prérogatives du Parlement et préservant les bases légales, le droit d’auteur et la liberté académique. Parmi les mesures proposées, les éditeurs saluent : un accompagnement des éditeurs vers plus d’ouverture, la nécessité d’études d’impact et le déploiement d’une véritable politique interministérielle en la matière.
Aujourd’hui, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche promeut le modèle d’accès libre aux publications scientifiques. Il met en place le « plan S » incitant les chercheurs à recourir à la licence Creative Commons (CC-BY, la plus libérale) pour la publication de leur article, et à le mettre en libre accès immédiat, couplé avec une stratégie de non-cession des droits des chercheurs aux éditeurs dits « Diamant ».
Avec ce modèle encore très minoritaire à ce jour, les publications seraient mises en ligne sans que l’indispensable travail d’édition soit financé par le lecteur (abonnements), ni par l’auteur, mais par des « sponsors », publics ou privés, à même de contester à terme l’entière liberté académique des chercheurs. L’OPECST note ainsi « qu’en sortant de la logique économique du marché et en reposant exclusivement sur des subventions publiques, ce modèle économique s’apparente à une étatisation pure et simple de l’édition du savoir et que l’on ne doit pas se résoudre au scénario de la domination programmée du modèle Diamant ».
En mars 2024, le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique a publié un rapport très positif sur la science ouverte et le droit d’auteur, qui recommande que le développement de la science ouverte se fasse en respectant le droit d’auteur ainsi que les intérêts de toutes les parties concernées, et fasse l’objet d’une gestion interministérielle.
Le 1er août 2024, le tribunal administratif de Nantes a constaté que l’Université de Nantes avait renoncé à obliger les chercheurs à publier en accès ouvert. Le SNE et la Société des Gens de Lettres (SGDL), qui s’étaient mobilisés contre cette politique allant à l’encontre du droit d’auteur et de la liberté académique, saluent ce changement, tout en appelant à la vigilance à l’égard de toute politique similaire au niveau français ou européen. En effet, en mai 2021, l’Université de Nantes avait instauré une obligation de dépôt des publications de ses chercheurs en archive ouverte et la prise en compte des publications ainsi déposées dans les évaluations institutionnelles et les dotations aux laboratoires. Philippe Forest, professeur de cette université, avait déposé en 2022 un recours auquel s’étaient associés la SGDL et le SNE.
Au niveau européen
Les ministres de la Recherche ont publié en mai 2023 des conclusions sur « La publication universitaire de qualité, transparente, ouverte, fiable et équitable », qui, contrairement à leur titre, visent à se passer des éditeurs.